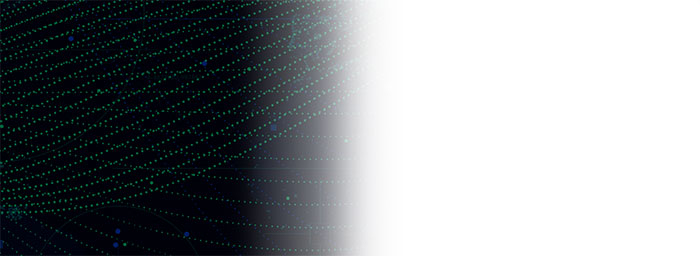Le 1er février 2025, le Canada est monté aux barricades à l’aube d’une guerre commerciale dévastatrice avec les États-Unis. Comme c’est toujours le cas dans un tel contexte, un pays puissant s’est attaqué à un voisin plus petit en lui énumérant la liste de ses doléances – son casus belli, ou son prétexte à une guerre. Et, comme toujours, le casus belli était faux. Il s’agit d’une relation prédateur-proie, où la guerre est le prédateur et la proie constitue l’objet, et non la cause, de l’attaque. Même si le président américain Donald Trump a accordé un sursis de 30 jours au Canada (et au Mexique, mais pas à la Chine) le 3 février, une incertitude existentielle continue de planer sur l’économie canadienne. Penchons-nous sur les arguments du président Trump et voyons où cela nous mène.
Le casus belli de Trump
La fiche d’information de la Maison-Blanche justifiant le décret à l’origine de la guerre commerciale avec le Canada indique que « la menace extraordinaire posée par les migrants clandestins et la drogue, y compris le fentanyl, constitue une urgence nationale en vertu de la loi relative aux pouvoirs économiques en cas d’urgence internationale (IEEPA). »
Ce décret précise ensuite, de manière incongrue, qu’« en 2023, le déficit commercial des États-Unis est le plus important du monde, se chiffrant à plus d’un billion de dollars », et fait ensuite l’éloge de l’efficacité des droits de douane. Ce sont des thèmes récurrents du président Trump – qui se plaint amèrement de la contribution du Canada à ce déficit commercial – mais ils n’ont rien à voir avec l’« urgence nationale » mentionnée.
La fiche d’information fait également valoir qu’« en votant massivement pour Donald J. Trump, les électeurs ont donné à ce dernier le mandat de fermer la frontière. C’est exactement ce qu’il fait. »
L’urgence
Les États-Unis sont assurément confrontés à une crise des opioïdes – tout comme le Canada (qui compte près de 50 000 décès attribuables à une surdose d’opioïde depuis 2016). D’où cette crise tire-t-elle son origine? C’est l’usage répandu d’OxyContin aux États-Unis qui a ouvert la porte au plus récent fléau associé au fentanyl, un autre opioïde qui crée une forte dépendance. Comme l’a indiqué le General Accounting Office (GAO) dans un rapport en 2003, « la Food and Drug Administration (FDA) a approuvé l’analgésique à libération contrôlée OxyContin de Purdue Pharma en 1995. Les ventes ont crû rapidement et, en 2001, l’OxyContin est devenu le médicament narcotique d’origine le plus prescrit pour traiter la douleur modérée à intense. En 2003, près de la moitié de tous les prescripteurs d’OxyContin étaient des médecins de premier recours. »
Les autorités américaines savaient-elles qu’il s’agissait d’un problème? Absolument. Le rapport du GAO souligne également ce qui suit :
- « L’ingrédient actif d’OxyContin est deux fois plus puissant que la morphine, ce qui pourrait avoir favorisé son mauvais usage. »
- « L’étiquette originale du médicament avisait les patients de ne pas écraser les comprimés pour éviter la possible libération rapide d’une quantité potentiellement toxique d’oxycodone. Cet avertissement pourrait avoir accidentellement attiré l’attention des toxicomanes. »
- « La hausse marquée de la disponibilité d’OxyContin pourrait avoir multiplié les occasions d’obtenir le médicament de façon illicite. »
La Drug Enforcement Agency (DEA) des États-Unis était consciente du problème, car elle « a déclaré craindre que la commercialisation agressive d’OxyContin en tant que médicament pour traiter une vaste gamme de troubles influence les médecins qui n’avaient peut-être pas reçu une formation adéquate en gestion de la douleur. »
La FDA, qui a approuvé le médicament parce qu’elle croyait que la formulation à libération contrôlée d’OxyContin comporterait moins de risques de dépendance en raison de son absorption lente par le corps et donc de l’absence d’euphorie (high) immédiate qui favoriserait l’usage abusif, a réprimandé Perdue pour avoir contrevenu à la réglementation en matière de marketing.
Ce sont donc les autorités américaines, qui ont approuvé le produit et ne sont pas intervenues par la suite, qui sont à l’origine d’un vaste problème de dépendance à un puissant opioïde, ouvrant la voie à la production d’autres drogues similaires, y compris le fentanyl. Il s’agissait d’un problème de taille extrêmement lucratif. Les États-Unis ont fini par poursuivre la société mère de Purdue Pharma pour avoir induit en erreur la population au sujet d’OxyContin en suggérant qu’il était moins addictif et qu’il convenait davantage à un usage général qu’en réalité, et ce, même si les autorités avaient approuvé le médicament précisément parce qu’elles croyaient que c’était le cas.
La crise qui sévit aux États-Unis en est une de demande, pas d’offre. Elle est locale – elle a pris son essor aux États-Unis. Elle a été causée par de graves erreurs de jugement et une négligence encore plus grave des autorités américaines.
La crise du Canada est également locale. Santé Canada a approuvé l’utilisation d’OxyContin au Canada en 1996, un an après que la FDA a approuvé le médicament. Les autorités canadiennes ont-elles fait preuve de diligence raisonnable? Pas selon cette récente évaluation rétrospective de la présentation du produit à Santé Canada par Purdue Pharma :
« Aucun des essais parrainés par Purdue Pharma n’a cherché à évaluer de manière significative les risques d’abus ou de dépendance associés à OxyContin. Les essais étaient de courte durée (la plus longue a duré 24 jours) et n’ont cherché qu’à évaluer l’innocuité et l’efficacité d’un intervalle posologique de 12 heures. De plus, les deux rapports d’essais qui ont expressément mentionné (mais qui n’ont pas officiellement évalué) le risque d’abus n’ont pas été publiés, ce qui rend difficile à comprendre comment Santé Canada a pu conclure qu’il n’y avait aucun risque d’abus. »
Si le Canada devait emboîter le pas et blâmer des étrangers pour ses erreurs, il aurait une raison légitime d’imposer de lourds droits de douane sur les exportations américaines en réponse à sa crise des opioïdes. Mais notre crise est de notre faute, tout comme celle des États-Unis est de leur faute.
La frontière
Les États-Unis sont très pointilleux par rapport à leur frontière, comme en témoigne un incident ayant fait l’objet d’une vaste couverture médiatique il y a quelques années. Une Française de 19 ans en visite chez sa mère en Colombie-Britannique joggait sur la plage, le long de frontière, lorsque des agents frontaliers américains ont remarqué qu’elle avait franchi la frontière non balisée. Ces derniers l’ont arrêtée, l’ont emmenée à un centre de détention privé à but lucratif se trouvant à 226 kilomètres de la frontière et l’ont détenue derrière des fils de fer barbelé pendant 15 jours avec 100 autres personnes.
Les services frontaliers des États-Unis contrôlent les personnes et les marchandises qui entrent aux États-Unis. Ils se trouvent du côté américain de la frontière et ont le mandat d’incarcérer tous ceux qui osent mettre ne serait-ce qu’un pied sur le territoire américain, une entreprise extrêmement lucrative.
Le Canada a également des services frontaliers. Ils se trouvent du côté canadien de la frontière et contrôlent les personnes et les marchandises qui entrent au Canada. C’est ainsi que fonctionne le processus. Le Canada ne délègue pas aux États-Unis la capacité de décider qui et quelles marchandises peuvent entrer au Canada, et il en va de même pour les États-Unis.
Circulation transfrontalière illicite
Le Canada possède l’un des cadres de réglementation des produits chimiques les plus rigoureux et lutte depuis longtemps contre l’importation de fentanyl, qui entre au pays en petites quantités presque indétectables – tout comme les précurseurs chimiques des opioïdes – par la poste. Ces dernières années, l’offre intérieure s’est accrue, comme le démontre la crise qui sévit au Canada, mais demeure le produit d’un système de fabricants éparpillés qui approvisionnent le marché intérieur.
Parallèlement, les États-Unis, c.-à-d. l’épicentre de la crise du fentanyl, possèdent l’un des cadres de réglementation des produits chimiques les plus permissifs au monde et ont affaibli leurs systèmes internes au lieu de les renforcer. Une étude Rand réalisée en 2019 a permis de constater qu’il est « essentiel d’améliorer le contrôle et la surveillance ». Une étude Brookings menée en 2024 s’est prononcée sur l’absence de mesures comme suit :
« Pour lutter contre la drogue, il faut réglementer les marchés, mais le gouvernement fédéral ne fait pas grande chose pour recueillir des données systématiques sur le marché. Une première étape facile consisterait à autoriser de nouveau les chercheurs à accéder au System to Retrieve Information from Drug Evidence (STRIDE), le système de données de la Drug Enforcement Agency qui contient des renseignements sur le prix et la pureté des drogues. D’autres étapes relativement simples consistent à renforcer le National Forensic Lab Information System (NFLIS), une base de données nationale sur les saisies de stupéfiants, à rétablir les programmes de surveillance des abus de drogues auprès des personnes ayant eu des démêlés avec la justice, et à mettre en œuvre des mesures de surveillance pour détecter la présence de drogues dans les eaux usées. »
L’abandon des opioïdes à base de plantes, comme l’héroïne et la cocaïne, au profit de produits synthétiques, comme OxyContin et le fentanyl, rend non seulement les substances plus mortelles, mais complique également leur contrôle en raison de leur faible coût, de leur faible détectabilité et de la vaste gamme de produits chimiques précurseurs de remplacement utilisés dans leur fabrication. Cette situation souligne la difficulté inhérente de lutter contre un problème lié à la demande au moyen d’une approche liée à l’offre.
Ce qui nous amène aux contrôles à la frontière. Comme le New York Times l’a indiqué, « l’an dernier [2024], les agents du service de douanes et de la protection des frontières des États-Unis ont intercepté environ 19 kilogrammes de fentanyl à la frontière nord, contre presque 9 600 kilogrammes à la frontière mexicaine. » La quantité de drogue qui entre aux États-Unis par le Canada représente 0,2 % de l’approvisionnement transfrontalier connu – et comme le Canada intercepte également du fentanyl en provenance des États-Unis, la quantité nette « d’importation canadienne » de fentanyl en sol américain est encore plus mince.
En ce qui concerne le flux de migrants, notons trois observations importantes :
- Premièrement, selon les données du service de douanes et de la protection des frontières des États-Unis, 198 929 personnes ont été arrêtées à la frontière canado-américaine au cours de l’exercice 2024 : « Il s’agit habituellement de personnes qui ne disposent pas des documents nécessaires pour entrer aux États-Unis ou qui demandent l’asile. » Autrement dit, il s’agit de personnes qui se présentent devant les autorités américaines pour tenter d’entrer légalement aux États-Unis, mais qui échouent. On parle souvent dans de tels cas d’« immigration clandestine », mais il s’agit en fait d’« immigration légale ayant échoué ».
- Deuxièmement, les données relatives à l’immigration réellement illégale – c.-à-d. les personnes qui parviennent à entrer dans un pays entre deux points d’entrée – ne sont pas connues (pour des raisons évidentes), mais le rapport entre le nombre de personnes arrêtées et le nombre de personnes « interpellées » est très petit. En Colombie-Britannique, par exemple, un reportage de la CBC a révélé qu’en 2023, 1 662 personnes ont été arrêtées sur 42 913 personnes interpellées, soit 3,9 % du total. Par conséquent, l’utilisation du nombre total de personnes interpellées pour exagérer le nombre de « migrants illégaux » constitue de la « Trumpagande ».
- Troisièmement, comme il y a un contre-courant de migration des États-Unis vers le Canada, l’entrée nette de migrants aux États-Unis est encore plus petite que la minuscule entrée brute.
En résumé, il n’y a aucune « crise » réelle à la frontière canado-américaine, tant sur le plan de l’immigration illégale que sur celui du trafic de fentanyl. D’autre part, les agents des deux côtés de la frontière connaissent les tactiques utilisées par les trafiquants de personnes et interviennent en suivant la procédure habituelle – sans l’application de sanctions douanières.
Une enquête menée par Price Waterhouse a permis de conclure que, bien qu’ils soient difficiles à mesurer, les coûts de la criminalité dans toutes les sphères de l’activité humaine – y compris les crimes en col blanc, les affaires de corruption, les flux financiers illicites, le trafic de stupéfiants, etc. – étaient inférieurs à 5 % du PIB et se situaient habituellement autour de 1 à 3 %. Les vols à l’étalage, les vols commis par les employés et les fautes de commission des fournisseurs, qui sont bien connus en raison de la diminution des stocks de détail par rapport aux ventes, constituent environ 1,6 % du volume total. Il s’agit en quelque sorte d’un « risque du métier » – et il existe une énorme différence entre un risque du métier et une « crise ». Il n’est cependant pas question ici de nier la nécessité de déployer des efforts pour limiter le risque – mais il importe de rappeler que les coûts sont inférieurs à 5 % précisément en raison des efforts déployés par les entreprises et les gouvernements pour mettre fin aux méfaits.
Et le commerce, dans tout ça?
La prétendue « crise » du fentanyl et de l’immigration illégale à la frontière canado-américaine, qui est à l’origine des sanctions douanières annoncées par l’administration Trump le 1er février 2025, constitue un argument spécieux. Par extension, l’entente qui a été conclue pour retarder l’imposition des droits de douane est vide de sens.
En plus d’être nuisibles à l’économie, ces droits ne permettraient pas d’atteindre les objectifs annoncés. Plusieurs entités en sont venues à ce constat, comme le comité de rédaction du Wall Street Journal, qui estime qu’il s’agit de la « guerre commerciale la plus stupide de l’histoire », ainsi que la Chambre de commerce des États-Unis, qui a déclaré ce qui suit : « L’imposition de droits de douane en vertu de l’IEEPA est sans précédent, ne permettra pas de résoudre les problèmes visés et ne fera qu’augmenter les prix pour les familles américaines et chambouler les chaînes d’approvisionnement. » Pendant ce temps, les analyses arrivant à des conclusions semblables se multiplient sur la blogosphère. Et ici, il convient de souligner que tout commentaire qui s’applique conjointement au Canada et au Mexique s’applique encore plus vigoureusement au Canada seulement.
Mais l’écosystème commercial souffrira si le système judiciaire et les intérêts institutionnels américains (y compris les sociétés commerciales et les États américains, qui dépendent du commerce avec leurs voisins) ne parviennent pas à s’opposer efficacement aux droits de douane, et si ces derniers, ainsi que les contre-mesures du Canada et du Mexique, sont mis en place pendant une période prolongée. En fait, un grand mal a déjà été fait, puisque la confiance envers l’économie nord-américaine a été ébranlée.
La mise en œuvre de droits de douane démesurés concorde également avec l’émergence de l’économie populiste, une importante vision de l’administration Trump selon laquelle la mondialisation cause du tort aux États-Unis, est responsable de sa désindustrialisation et constitue la principale source de tous les maux sociaux du pays, y compris la mort et le désespoir associés à la crise du fentanyl. Même si l’on fait fi de la sombre possibilité que les États-Unis en profitent pour tenter de procéder à l’annexion du Canada, le Canada pourrait devoir apprendre à survivre et à prospérer dans un monde très différent de celui auquel il était habitué si les États-Unis mettent leur menace à exécution.
Donald Trump a mis de l’avant son casus belli dans son décret visant à imposer des droits de douane au Canada et au Mexique. La réalité est tout autre comme c’est habituellement le cas pour ce genre de scénarios – Paul Krugman a comparé le fentanyl dans la présente situation aux armes de destruction massive inexistantes qui ont été invoquées pour justifier une autre guerre entre une grande puissance et un pays de moins grande envergure, à savoir l’invasion de l’Irak dirigée par les États-Unis en 2003. Et si l’on se fie au passé, les conséquences de la politique commerciale « America First » (l’Amérique d’abord) ne seront pas celles anticipées par ses auteurs.